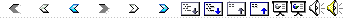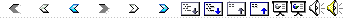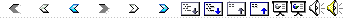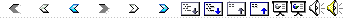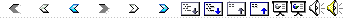|
1
|
- En Vienne 86
- Email pour corrections, modification: emile@fauvet.nom.fr
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
|
11
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
15
|
|
|
16
|
|
|
17
|
|
|
18
|
|
|
19
|
- Le 23 février 1910, l’administration des ponts et chaussées (police des
eaux) autorise
Monsieur Fernand Tribot, banquier à Montmorillon, à construire un
barrage au châtelard ( commune de Lathus) pour les besoins d’une usine
hydroélectrique.
En 1912, il céde le droit acquis à Monsieur Chauvaud et
compagnie, constructeur demeurant 23 quai des Queyries à Bordeaux. Ce
dernier souhaite remplacer la maçonnerie de moellons granitiques prévue
au centre du barrage par du béton de chaux hydraulique et cailloux de
roches granitique, car il ne trouve pas assez de maçons dans le pays
pour faire le barrage dans l’été 1913.
La hauteur du barrage serait de 9,50m, au dessus du lit, la
largeur au niveau de la retenue de 2,5m . La largeur à la base serait de
9,5 m. Parement vertical en amont.
Le parement aval serait formé d’un profil parabolique à la partie
supérieure et d’une ligne polygonale à la partie inférieure. Il serait
fondé sur le granite qui constitue le lit de la rivière, encastré dans
la roche de 50 cm au moins sur toute sa longueur et de 1 m à ses
extrémités.
- On sait que les travaux sont commencés le 19 octobre 1912…
- Le 21 octobre, l’administration adresse une mise en demeure de faire les
travaux, à défaut elle retire son autorisation ( AD86-7S46)
Les travaux retardés à la demande de Monsieur Chauvaud ( pour
étude des propriétés du béton) ne sont pas achevés lorsque la guerre
1914-18 survient. Ils ne reprendront jamais, ce qui sauve le site des «
Portes D’enfer ».
|
|
20
|
|
|
21
|
|
|
22
|
|
|
23
|
|
|
24
|
- RIGAUD Louis, Eugène (o14/11/1851 au Moulin de la Prade à SAULGE) est
cultivateur, propriétaire puis marchand de vins. Il se marie à METAYER
Marie Radégonde, en 1879 à PLAISANCE. Il est maire de cette commune de
1896 à 1904. Il réside dans le bourg, rue Sainte Catherine.
|
|
25
|
|
|
26
|
|
|
27
|
|
|
28
|
|
|
29
|
|
|
30
|
|
|
31
|
|
|
32
|
|
|
33
|
|
|
34
|
|
|
35
|
- La papeterie du Moulinet des Mâts, près de Montmorillon, fonctionne depuis
1602 sur la Gartempe, sous l'autorité des Augustins de la Maison-Dieu.
En 1843, de nouveaux propriétaires commencent des travaux pour créer une
brasserie. Ce qui fait l'originalité de la démarche c'est qu'elle
s'appuie sur des données naturelles très favorables alliant quantité et
qualité de l'eau (plan cadastral de 1897).
- La fabrication de la bière nécessite de l'eau de bonne qualité et en
consomme beaucoup : il faut 10 hl d'eau pour faire 1 hl de bière.
D'autre part, l'eau doit présenter de bonnes qualités organoleptiques
afin de donner un goût agréable à la bière. Le débit de la Gartempe doit
être suffisant pour produire l'énergie nécessaire. Le site choisi offre
tout cela.
- L'eau qui percole au travers des assises de calcaires dolomitiques à
l'aplomb du site sont limpides « bicarbonatées calciques et
magnésiennes, légèrement fluorées, de dureté et de minéralisation
moyenne », particulièrement bien adaptées à cette fabrication. Ces eaux
sont rassemblées dans un bassin ou « étanche ». La quantité d'eau
indispensable au brassage provient de deux sources achetées par la
famille Duvigier.
- L'eau de la Gartempe sert à produire de l'énergie . L'entreprise connaît
une expansion très rapide puisqu'au bout de 3 ans, 5 814 hl de bière
sont produits et que 20 ouvriers travaillent dans la fabrique.
- Nous n'évoquerons pas tous les aspects de cette activité, symbole d'une
réussite familiale, mais nous voulons souligner deux caractères
originaux de cet établissement.
- C'est d'abord l'accord parfait entre l'héritage d'une tradition de mise
en valeur d'un site à partir de l'eau et le choix d'une production
adaptée au contexte économique de l'époque. D'autre part, c'est
l'expression d'une conception sociale de l'entreprise. Monsieur Pillot,
propriétaire en 1879, conçoit un système de relations sociales basées
sur une hiérarchisation et des avantages en nature. La brasserie occupe
une place importante dans la vie locale et le renom de la bière de
Montmorillon dépasse les limites régionales, mais faute d'avoir
modernisé les installations en temps utiles, l'entreprise périclite et
cesse toute activité en 1962.
|
|
36
|
- Deux moulins à papier, construits au 17e siècle, sont transformés en
brasserie et en minoterie en 1843 pour les frères Duvigier ; une
malterie est édifiée en 1855 (porte la date) ; la brasserie est vendue
par saisie judiciaire à Jules Butaud en 1858 ; en 1879, l'affaire est
reprise par son fils, Etienne Butaud, son gendre, Maurice Pillot, et
deux amis, Eugène et Gustave Renaud ; en 1889, de grands travaux sont
entrepris par Etienne Butaud, comme l'installation de turbines
hydrauliques, celle de machines à glace et la construction de caves pour
la fermentation basse, nouvelle technique de fabrication ; la direction
de l'entreprise passe en 1899 à Henri Baugier, aide à partir de 1906 et
1908 par Maurice Sotias et Georges Pillot, puis en 1922 par son fils,
Jacques Baugier ; les bureaux sont édifiés en 1929 (date portée) , alors
que cesse l'activité de la minoterie ; en 1931, la production annuelle
est de 30 000 hl de bières vendues dans un rayon de 200 km, à quoi
s'ajoutent des eaux gazeuses, limonades et sodas ; l'eau utilisée
provient d'une source voisine, les orges sont récoltés en France, tandis
que les houblons sont importés de Tchécoslovaquie ; la tonnellerie est
réalisée sur place ; la malterie ferme en 1936 entraînant une diminution
du personnel ; un atelier d'embouteillage est construit vers 1938 ;
depuis la cessation d'activité en 1963, les bâtiments sont pour certains
désaffectés, d'autres transformés en logements, d'autres encore abritent
une activité industrielle.
En 1889 : machine frigorifique Raoul Pictet ; 1 roue hydraulique
au rez-de-chaussée de la malterie ; en 1895 : 6 chaudières (4 pour la
fabrication, 2 pour l'eau chaude) ; machine fixe de 25 cv remplacée en
1901 par une machine de 100 cv.
en 1931, environ 50 ouvriers
|
|
37
|
|
|
38
|
|
|
39
|
- Moulin à blé et à foulon, bâti à l'emplacement d'un moulin à papier à 3
roues hydrauliques édifié en 1603 et autorisé par Henri IV, reconstruit
après un incendie en 1857. En 1881, Léonard Piaux installe dans le
moulin à foulon une carderie, une teinturerie et une filature. A côté
sont regroupés une scierie, un moulin à tan et à blé. La filature cesse
son activité en 1909. En 1918, c'est un moulin appartenant à M. Beaugier
et Magnon, qui est transformé par la suite en minoterie. Puis, une
blanchisserie industrielle tenue par René Mahieu s'y installe en 1927,
équipée de machines pour le lavage, le repassage et le glaçage du linge
provenant des villes environnantes, de Poitiers et de Châtellerault.
L'ancien moulin à foulon du côté est est alors partiellement
reconstruit. Puis, s'y effectue l'ensachage de la farine fabriquée aux
grands moulins de Montmorillon. Toute activité industrielle cesse en
1969, et les bâtiments sont soit démolis, soit convertis en
logement.
En 1931, la blanchisserie dispose d'une force hydraulique de 30
ch suppléée par l'électricité en cas de basses eaux.
En 1931, la blanchisserie emploie 40 personnes description
Premier atelier de fabrication de 1857 à 1 étage carré couvert d'un toit
à longs pans à croupe polygonale en ardoise ; bâtiment de réception du
linge, en rez-de-chaussée, couvert d'un toit à longs pans à croupes en
ardoise ; ancien moulin à foulon reconstruit dans les années 1930 à 3
étages carrés couvert d'un toit à longs pans en ardoise
|
|
40
|
|
|
41
|
- Moulin à blé reconstruit probablement au 18e siècle sur l'emplacement
d'un ancien moulin à blé dont subsiste le logement patronal et qui
dépendait de la Maison Dieu de Montmorillon, équipé de 4 roues
hydrauliques. Le moulin est en ruines en 1898, et en 1912 est construite
une minoterie quelques dizaines de mètres plus loin, sur l'emplacement
d'un ancien bâtiment à usage de grange et d'écurie, pour Alain de
Montplanet. Entre 1939 et 1946, le vieux moulin produit de l'électricité
pour faire fonctionner la minoterie, mais un moteur thermique supplée
cette énergie en cas de basses eaux. En 1946, le gérant, Jean Morillon,
rachète l'usine, fait surélever la minoterie pour l'installation d'un
plansichter et l'agrandit. A partir de 1946, l'électricité est achetée,
et l'on fabrique de l'alimentation pour bétail dans l'ancien moulin. La
farine, produite sous l'appellation Fina-Flora, est commercialisée en
Touraine, Gironde et Côte d'Azur par camions. L'empaquetage est assuré
dans 4 ateliers sur place, et un autre au moulin des Dames. L'usine
cesse de fonctionner en 1967 pour cause de difficultés financières, et
le matériel est vendu.
Dans les années 1950, 40 personnes sont employées
|
|
42
|
|
|
43
|
|
|
44
|
|
|
45
|
|
|
46
|
|
|
47
|
- Monsieur de Brettes transforme le moulin de Gâtebourse pour produire de
l’électricité afin d’alimenter sa beurrerie modèle du Roc-St-Louis
|
|
48
|
|
|
49
|
- Moulin à blé reconstruit vers 1850 pour les frères Duvigier de Mirabal.
Après la faillite de ces derniers, leurs biens sont vendus aux enchères
en 1858, dont pour ce site un atelier d'ajustage de menuiserie, deux
forges et la minoterie nouvellement construite, rachetés par Hippolyte
Maréchaux. Ce dernier construit en 1860 une usine de construction de
machines agricoles (un manège locomobile et un laveur de racines sont
présentés à l'exposition universelle de 1867) et sans doute le logement
patronal. L'usine est rachetée en 1897 par René Mahieu, qui fait
construire un magasin industriel en 1899. En 1902, une scierie mécanique
pour le bois de construction, mue par une machine à vapeur, s'installe
dans un ancien hangar. Georges Tribot devient propriétaire de
l'établissement en 1908. En 1911, un chemin de fer Decauville dessert
l'usine. Le site est vendu en 1920 pour servir de dépôt à l'Alimentation
du Poitou ; puis, en 1940, une cidrerie est édifiée sur l'emplacement
des ateliers. En 1960, après l'achat du site par Fernand Lebon, les
locaux sont désaffectés, et ne subsistent aujourd'hui que le moulin à
blé, le logement patronal, la cidrerie et des magasins.
Le mécanisme du moulin à blé était mu par deux roues verticales
vendues vers 1960.
En 1861 : 40 ouvriers
|
|
50
|
|
|
51
|
|
|
52
|
|
|
53
|
- Au pied du château, le long de la Gartempe, se trouve le moulin de
Pruniers, déjà mentionné en 1579. Endommagé par le temps et les crues,
il fut l’objet de premières réparations au XVIème s. par le seigneur de
Pruniers, puis d’une reconstruction partielle en 1857. Le mécanisme, la
roue à aubes, le moteur et quatre paires de meules ont été conservés.
|
|
54
|
|
|
55
|
|
|
56
|
|
|
57
|
- II date du XVе siècle (1486) et a toujours produit de la farine.
En 1874 son équipement consiste en deux roues à aube et deux paires de
meules.
- En 1995 ce moulin produit l'électricité nécessaire à son activité. Deux
turbines ont été installées : une « Francis » en 1950 (25 cv), une autre
en 1980 (100 cv) qui consomme 2 000 litres d'eau par seconde, pour une
production de 22 kW. Le système fonctionne 20 heure sur 24 (sauf les
samedis et dimanches). Le moulin peut, en période de débit moyen,
assurer sa consommation d'électricité mais lors d'étiages ou de trop
forts débits il doit acheter le complément à EDF.
- Les blés proviennent de la Vienne et de l'Indre pour une production de
farine de 50000qx par an. Ce qui fait la particularité de cette
minoterie c'est l'organisation de la production. Ce moulin est associé à
celui de Vrassac (Béthines) qui appartient à la même famille de meuniers
: la mouture se fait à Antigny alors que le conditionnement est réalisé
à Béthines où a été également installé un laboratoire d'analyses de
farine. Huit personnes sont employées sur les deux sites.
- La commercialisation s'étend dans la région ainsi que dans les pays
d'Outre-Mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Les sous-produits ne sont
pas traités ici mais envoyé à Châtellerault et Ingrandes, dans des
usines de fabrication d'aliments du bétail.
|
|
58
|
|
|
59
|
|
|
60
|
|
|
61
|
|
|
62
|
|
|
63
|
|
|
64
|
|
|
65
|
|
|
66
|
|
|
67
|
|
|
68
|
|
|
69
|
|
|
70
|
|
|
71
|
|
|
72
|
|
|
73
|
|
|
74
|
|
|
75
|
|
|
76
|
|
|
77
|
|
|
78
|
- Fernand Gaudy: Les Moulins du bassin de la Gartempe XXXe Festival de
Bellac 1983
- René Brun: Le canton de Châteauponsac et … ses derniers moulins
- Bases Architecture et Patrimoine
- Les bases de données
documentaires mises en oeuvre par la direction de l'Architecture et du
Patrimoine, sont administrées par la sous direction des études, de la
documentation et de l'Inventaire. Elles sont enrichies par les travaux
de l'Inventaire général du patrimoine culturel, des Monuments
historiques, et de la médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine.
-
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
|
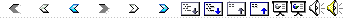
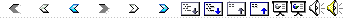
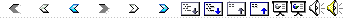
 Remarques
Remarques